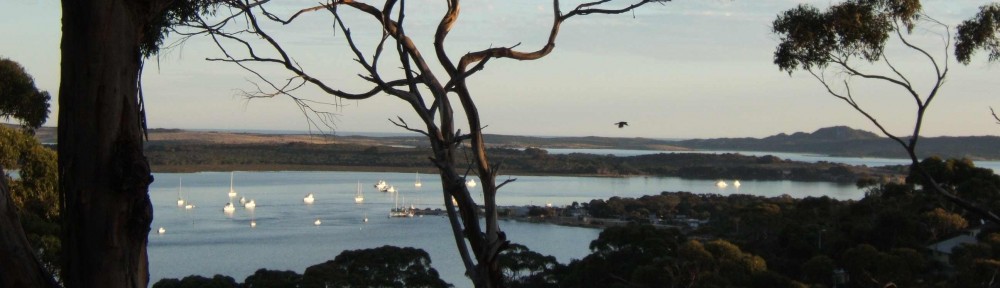Category Archives: mécanismes cognitifs
D’un canidé préhistorique… au chien domestique
août 21st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #98.
Les canidés naturels, loups, renards, coyotes, chacals, sont des splendeurs de joliesse, de finesse et d’intelligence, autant que les félidés, selon d’autres lignes. On peut admirer leurs pattes élancées, leur démarche équilibrée, leur fin museau, leurs belles oreilles dressées, leurs regards intenses et intelligents, que leurs pupilles soient rondes, comme chez les plus grands (les loups), ou en fente verticale, comme chez les plus petits (les renards).
Cela, c’est sur le plan naturel. Par contre, sur le plan artificiel, les hommes n’ont pas créé grand-chose de bon à partir de ces génomes de qualité, au contraire. Celui des chiens est beaucoup plus plastique que celui des chats, et leur transformation, tant physique que mentale, depuis leurs origines non domestiques, par l’élevage et la sélection non naturelle, a débuté il y a bien plus longtemps. Les hommes ont donc largement laissé leur marque sur ce génome. Le prototype canin, à la grâce et à l’efficacité affinées sur des millions d’années d’évolution, a, en cours de route, été jeté aux orties par eux ; à sa place, les éleveurs ont fabriqué, le plus souvent, des formes monstrueuses, laides, malades.
Ce que la sélection humaine a ainsi fait, de la lignée préhistorique de canidés qui a mené aux chiens, est révoltant. Distorsions physiques et psychiques en tous genres… qui d’ailleurs continuent à être perpétrées, chez la plupart des éleveurs de races.
En particulier, la sélection, sur des millénaires, des chiens, pour en faire des êtres entièrement axés sur l’obéissance aux humains, et à la satisfaction des moindres caprices de leurs maîtres, est à l’origine d’animaux au psychisme et à l’intelligence particuliers – des génies mentalement handicapés. Ainsi voit-on les chiens déployer des trésors d’intelligence pour faire plaisir aux humains… à leur propre détriment, souvent. Car les humains abusent volontiers de la prédisposition favorable des chiens à leur égard, cela de façon indigne, voire cruelle.
Cette situation est d’autant plus odieuse que la plupart des chiens ne deviennent jamais adultes psychiquement… demeurant, toute leur vie, mentalement néoténiques. Faire du mal à un chien adulte, c’est encore faire du mal à un chiot.
Sur cette dernière réflexion, un avertissement toutefois : les chiens ne s’avèrent pas tous des chiots dans l’âme ! En effet, la sélection humaine des chiens, par l’élevage, a fait pire, éthiquement, que ce qui vient d’être évoqué. Depuis des millénaires, on a aussi sélectionné, en parallèle aux races aimables, des races hyper féroces, armes vivantes chez qui on a supprimé tout sens naturel de la peur. Au cours de leur croissance, ces monstres ne s’avèrent jamais vraiment des chiots, mais ne deviennent jamais vraiment adultes, non plus. Des animaux psychopathes, en définitive. Cette histoire-là est particulièrement sinistre.
***
Systèmes nerveux dans un organisme, développements parallèles
août 20th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #95.
Au sein des organismes qu’elle façonne, l’évolution met souvent en place des systèmes parallèles, d’une façon qui peut, de prime abord, sembler exagérément redondante. Les systèmes nerveux, parmi d’autres exemples, étonnent de ce côté. On en déduit, logiquement, que leur élaboration progressive s’est faite par des bricolages successifs [1]. Ces derniers, toutefois, ont été affinés par des centaines de millions d’années de sélection naturelle. D’où des merveilles, étourdissantes, de complexité.
Voyons cela de plus près.
Dans un premier cas de développement en parallèle, très tôt la nature met en place quatre systèmes nerveux différents chez les animaux : le système nerveux entérique pour tout ce qui a trait aux fonctions alimentaires et excrétoires, le système nerveux autonome (SNA) ou végétatif, le système nerveux somatique (SNS), tous trois rassemblés sous la dénomination (commode mais pas nécessairement physiologique) de système nerveux périphérique (SNP), et le système nerveux central (SNC). Leur développement évolutif se fait chacun de son côté, mais en intégration mutuelle.
Il est difficile d’établir lequel des quatre est apparu en premier… Parmi ces quatre, le système entérique est le plus obscur et le moins connu, le SNC est le plus célèbre. On observera toutefois que, si un bon contrôle par le SNC des réactions aux stimuli extérieurs et des déplacements s’avère vital… un bon contrôle de la digestion l’est encore plus. D’ailleurs, bien des animaux, dans leur forme adulte, ne se déplacent plus du tout… mais ils ont tous besoin, à toutes leurs étapes de vie, de digérer convenablement.
Dans un deuxième cas de développement en parallèle, le système nerveux entérique est constitué de deux plexus ganglionnaires s’étendant sur toute la longueur du tractus digestif, un plexus étant surtout chargé des sécrétions glandulaires et du débit sanguin local, l’autre l’étant principalement de la motricité (péristaltisme).
Par ailleurs, le SNC et le système nerveux entérique se trouvent eux-mêmes en interface avec le système nerveux somatique, SNS qui non seulement contrôle les neurones sensitifs, mais encore stimule les muscles squelettiques (qui n’incluent pas le myocarde et les muscles lisses). Il s’agit là d’un troisième cas de développement en parallèle, avec la particularité que le même organe nerveux, le SNS, gère ici deux fonctions très différentes… avec tous les risques de confusion que cela entraîne lors de la gestion des signaux !
Dans un quatrième cas de développement en parallèle, la nature règle à sa façon le problème en créant, au sein du SNS, un double sous-système de gestion spécialisée, très particulier, pour la fonction de stimulation des muscles squelettiques, qui se trouve de la sorte bien séparée de la gestion des neurones sensitifs. Sous-système double, puisque dans leur motricité volontaire ces muscles sont contrôlés par un premier sous-système, dit pyramidal, alors que dans leur motricité involontaire ils le sont par un second, dit extrapyramidal. Cette dernière séparation de sous-systèmes se révèle cruciale, car elle empêche que la motricité involontaire, indispensable pour les mouvements réflexes et les réactions immédiates, soit sabotée par des ordres volontaires, qui ne sont pas affinés, eux, par des millions d’années d’adaptation.
À ce terme de notre évocation des différents systèmes nerveux, on conçoit déjà qu’un tel enchevêtrement puisse nécessiter une centrale de traitement, à partir d’un certain niveau de complexité morphologique. Dans un cinquième cas de développement en parallèle, triple en l’occurrence, la nature adjoint alors au SNC trois nodules nerveux situés dans la tête (dans l’encéphale), tous trois dérivés de la moelle épinière (soit la partie spinale du SNC). Le tronc cérébral, responsable de fonctions physiologiques essentielles, telles que la régulation de la respiration, du rythme cardiaque, des cycles du sommeil, mais aussi la gestion des signaux de douleur, de la plupart des signaux nerveux de la face, du cou et de la nuque, ou encore la localisation des sons, etc. Le cerveau proprement dit, aux fonctions très étendues puisqu’il gère, inter alia, non seulement la mémoire et les fonctions cognitives (dont une grande part des informations sensorielles), mais également, à sa base anatomique, tout le système limbique, aux fonctions essentielles également (le contrôle homéostatique de la thermorégulation, les émotions, etc.). Plus le cervelet, ou “ petit cerveau ”, un organe assez spécialisé qui ne gère pas la génération des gestes et des mouvements du corps, qu’ils soient volontaires ou involontaires (on a vu que c’est un sous-système du SNS qui a cette responsabilité), mais qui plutôt leur coordination, leur synchronisation et leur précision.
Sixième cas de développement en parallèle : le SNC, le SNS et le système nerveux entérique sont en interaction étroite avec le système nerveux autonome (SNA) ou végétatif. Ce dernier gère une bonne partie des fonctions et organes non soumis au contrôle volontaire : les muscles lisses des systèmes digestif, urinaire et vasculaire, les muscles cardiaques, de nombreuses glandes exocrines ou endocrines. Le système nerveux autonome est chargé du maintien de l’équilibre du milieu intérieur, ou homéostasie, ce qui implique des interactions très complexes entre les fonctions physiologiques et la plupart des comportements de l’organisme.
Septième cas de développement en parallèle : dans le SNA, la nature prévoit une manette d’accélération, mais aussi une manette de frein. Un métabolisme peut être accéléré en appuyant sur la pédale ad hoc, mais souvent il faut pouvoir s’arrêter brutalement, juste lever le pied de l’accélérateur ne suffisant pas. Grâce à ces deux manettes, le système neuro-végétatif s’avère à la fois plus stable et plus réactif, et le risque d’erreur est diminué.
La manette d’accélération, mobilisatrice d’énergie dans l’organisme, donc stimulatrice, fonctionne essentiellement à l’adrénaline (une hormone et un neuro-transmetteur [2]) : c’est la composante dite orthosympathique, qui gère les comportements de flight or fight ! – fuis ou combats !
La manette de frein, économisatrice d’énergie, fonctionne à l’acétylcholine (un autre neuro-transmetteur) : c’est la composante dite parasympathique, qui gère non seulement l’immobilisation et le repos (freeze ! lay down ! – bouge plus ! couche-toi !) mais, aussi bien, des aspects de l’alimentation et de la reproduction… car il faut pouvoir consacrer à la digestion l’énergie disponible, et l’organisme maternel doit savoir s’économiser pour ses petits (comportements de feed or breed ! – nourris-toi ou multiplie-toi !).
Bilan : rien que dans cette première approche, très schématique, on aura noté comment la nature a opéré, au sein d’un organisme animal, sept développements en parallèle de systèmes nerveux. La tendance au parallélisme se confirme lorsqu’on étudie plus en détail ces systèmes : de nouveaux cas apparaissent alors sous la loupe. Par exemple, il peut y avoir plusieurs types, parfois très différents, de récepteurs biochimiques pour un même neurotransmetteur. Ou encore, dans le bulbe rachidien du tronc cérébral, il y a un centre pour l’inspiration, un autre pour l’expiration, la rythmicité respiratoire étant réglée par un troisième noyau ; il y a un centre pour l’accélération du rythme cardiaque, un autre pour l’inhibition ; la pression artérielle est finement et très rapidement régulée par des centres vaso-constricteurs (qui contractent les muscles lisses des artérioles) et par des centres vaso-dilatateurs (qui ont l’effet inverse)… Etc.
Somme toute, cette redondance répétée des systèmes nerveux les rend plus fiables et très souples à l’emploi. Parfois, pourtant, elle n’est pas simple à gérer pour l’organisme. Un exemple frappant de cette difficulté est le choc vagal, un phénomène neuro-végétatif violent, au cours duquel la composante cholinergique, ou parasympathique, du système nerveux autonome, prend brutalement le dessus, jusqu’à évanouissement, sur sa composante adrénergique ou orthosympathique (celle qui, sous une décharge d’adrénaline, libère une grande quantité d’énergie pour le combat ou pour la fuite). À première vue, le choc vagal paraît tout simplement un défaut de système, un dysfonctionnement comme il peut en arriver sur le plan des probabilités.
Quoique… Est-on sûr que le choc vagal ne soit qu’un handicap ? En termes évolutifs, il pourrait bien avoir son utilité…
[1] Cf. supra le texte no 20, « Ailes et plumes des origines ». Cf. aussi « Le réveil de formes trop anciennes » ainsi que « Le bonheur et la sérénité, ou bien l’excitation et le plaisir ? », textes nos 104 et 105 de Pensées pour une saison – Printemps.
[2] Cf. supra le texte no 12, « Le bâillement de réveil – un cas d’évolution surprise ». Cf. infra les textes nos 96 et 97, « Choc vagal, avantage évolutif inattendu », ainsi que « Le combat à mort du chat et celui des défenseurs français de Verdun ». Enfin, cf. « Le bonheur et la sérénité, ou bien l’excitation et le plaisir ? », le texte no 105 de Pensées pour une saison – Printemps.
***
L’étrange histoire d’une traduction bancale et de ses conséquences sur une vie
août 19th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #93.
Le travail des traducteurs m’a toujours fasciné, depuis ma petite enfance déjà. Les traducteurs, souvent, font plus que mettre à disposition des textes autrement inaccessibles, ils peuvent, également, valoriser ou dévaloriser ces textes.
Ma première découverte de cette réalité se fit à travers les traductions en français, sous le label Le Club des Cinq, des Famous Five de l’Anglaise Enid Blyton [1897-1968], une série de romans pour enfants rédigés par elle entre 1942 et 1963. Au moins une demi-douzaine de traductrices avaient été mises à la tâche entre 1955 et 1967, et dans l’ensemble elles s’en étaient honorablement acquittées.
Le Club des Cinq va camper, une traduction de 1957 de Five go off to camp, dans ses éditions Nouvelle Bibliothèque rose (1960 ; mon exemplaire était de 1969), présentait une couverture de Paul Durand [1925-1977]. Un véritable trésor onirique. Avec son titre, le livre, annonciateur de petit paradis programmé, me faisait gentiment rêver de grande nature, ainsi que de relations familiales douces et harmonieuses.
Déjà tout petit, je vénérais la langue française. La traductrice de l’anglais maniait bien sa propre langue, c’était donc très agréable à lire. Mais il y avait des zones d’ombre dans le livre…
Annie, la cadette, s’avérait la seule sachant cuisiner. Pour moi, par sa douceur, son entregent et son sens des responsabilités, elle se révélait le personnage central. Aussi avais-je été particulièrement choqué par un passage, où un aîné invectivait sa petite sœur, injustement et sur un ton déplaisant :
« Qu’est-ce que ça veut dire, « ganaches »? demanda Annie.
– Ça veut dire idiots, petite sotte », riposta Michel.
J’étais interloqué, déçu. C’est normal, pensais-je, de ne pas connaître tous les mots, c’est bien de demander leur sens ! Ce Michel était déplaisant…
Un an plus tard, à l’installation de ma famille en Europe, alors que j’avais onze ans, je relus le récit (car j’imaginais qu’il me faudrait apprendre à camper en France…) – pour me trouver confronté à un mystère. Au début du chapitre 3, était évoqué un « courlis »…
La description poétique de l’appel de l’oiseau me plaisait et je consultai alors ma petite bible ornithologique acquise à l’époque, Oiseaux – Atlas illustré, de Spirhanzl-Duris et Solovjev, 1ère édition française de 1965. Ce qui me plongea dans des abîmes de perplexité. En effet, j’y lisais que le courlis est « un oiseau des marécages (…) des lacs et des régions côtières du nord ». Or le récit (en français) se déroulait sur des hauts plateaux froids, que j’avais laborieusement, et correctement, associés au Massif Central… sur lesquels il ne pouvait pas y avoir le moindre courlis !
J’étais perplexe, à nouveau déçu. L’auteure ne sait pas de quoi elle parle, me dis-je. Je m’éloignai de ses livres.
En 1985, mon épouse me faisait lire Je vous écris d’Italie, que Michel Déon [1919-2016] venait de publier l’année précédente. Nous demeurions à Gersau, sur le Lac des Quatre-Cantons. Je lisais avec plaisir, dans la Stube du très vieux chalet de sa tante, ce roman empreint d’atmosphère, le lac splendide et les Alpes magnifiques s’offrant à la vue au-dehors. Je tombai alors sur le passage suivant :
« Il y a entre imbécile et imbecille une énorme différence. Le mot italien peut se hurler, il reste chaleureux. Jacques aimait bien la façon dont le maire disait imbecille d’une voix magnifique, étalant le triomphe de l’intelligence autoritaire sur la stupidité prolétarienne. »
À cet instant, j’eus une intuition. Quelque temps plus tard, de retour à Genève, je réussis à mettre la main sur Five go off to camp, le texte original de Blyton publié en 1948. Et je pus résoudre les deux problèmes nés avec la traduction française de 1957.
Le texte original en anglais était :
« What’s an idjit ?’ asked Anne.
‘An idiot, silly,’ said Dick. »
L’expression « silly » n’a absolument pas, en anglais, la tonalité méprisante de « petite sotte », dont avait usé la traductrice ! Nigaude eût mieux convenu… Et encore… Le contexte rendu n’était pas le même, il y avait un monde entre ne pas comprendre un accent… et ne pas connaître un mot rare. De plus, l’usage du verbe « riposta », nullement nécessaire, accentuait le côté agressif de la réplique, par là le malaise d’un petit lecteur francophone sensible. Quoi qu’il en soit, la traductrice, ayant choisi de faire l’impasse sur l’aspect amusant d’une prononciation paysanne inattendue, aurait dû, en toute logique, faire l’impasse complète sur ce petit dialogue, qui n’avait plus sa place !
Elle n’était pas allée au bout de son travail d’adaptation.
Pour mon édification, je lus alors le récit original entier en anglais, la traduction à portée de main, pour comparaison. Je ne m’ennuyai pas autant que je ne l’avais craint. Et je résolus alors le mystère ornithologique !
Blyton avait situé son récit dans les moorlands du nord-ouest de l’Angleterre, au climat froid… où, effectivement, vit le courlis. La traductrice, en francisant géographiquement le récit (selon la volonté de l’éditeur français, et cela dès la première traduction pour la série, en 1955), avait œuvré à donner l’impression que le Club des Cinq (des petits Français, donc) s’en allait camper sur des hauts plateaux désertiques et, sans qu’elle ne le dise explicitement, il s’avérait clair qu’elle avait le Massif Central en tête.
C’était une bonne idée, mais… en conservant l’oiseau courlis dans le récit, elle avait fabriqué une aberration ornithologique ! Elle aurait dû évoquer, à la place du courlis cendré, le cri d’un oiseau vivant en été dans le Massif Central.
Par ailleurs, je notais quelques menus problèmes supplémentaires, de botanique en l’occurrence, nés de cette transposition, et que je n’avais pas remarqués dans mon enfance.
Enid Blyton n’était pas à blâmer, en aucune façon. Dans les deux cas d’espèce, il s’agissait d’une maladresse de la traductrice, qui, encore une fois, n’était pas allée au bout de son adaptation de l’anglais.
Ce fut là sans doute le tout premier écrit où je me trouvai confronté à des problèmes de traduction inadéquate. Avec le recul, je constate que cela m’a profondément marqué, et orienté mentalement pour la vie. Cette double mésaventure, disons affective et cognitive, a contribué à mon goût de la parole juste et de la traduction minutieuse, autant qu’adroite. J’y repense avec un grand sourire.
Toute bonne traduction est un mystère. Elle emmène le lecteur dans une florissante randonnée à trois. Une mauvaise traduction, par contre, est un dédale obscur. Mais quand on sort de celui-ci par ses propres efforts… quel triomphe !
***
Défendre son lieu sûr
août 18th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #90.
Depuis longtemps, j’observe attentivement les chats. Un trait caractéristique de l’espèce est l’importance accordée au lieu sûr.
Pour chacun, la priorité absolue est de s’assurer, régulièrement, que celui-ci lui demeure exclusif. S’il doit y revenir en vitesse, il doit pouvoir s’attendre à ce qu’il ne soit pas investi par un autre. Il l’inspecte donc fréquemment, ainsi que son environnement, et si nécessaire prend une posture de combat face au chat ou à l’animal qui approche trop du périmètre de défense de ce lieu.
Ou alors, si celui-ci n’est plus défendable, il se met en quête d’un autre refuge. Pendant cette période de recherche le chat, animal courageux mais spontanément angoissé, devient particulièrement anxieux. L’angoisse que provoquait le souci d’avoir à défendre son lieu sûr a laissé place, pour un temps, à l’anxiété de la recherche. Le petit être n’a pas le choix toutefois, il doit persévérer, car il lui faut un nouveau lieu sûr afin de pouvoir y trouver refuge en cas de coup dur.
Quoique cela ne soit pas entièrement et toujours vrai… Dans les chatteries, dans les meilleures familles, on trouve parfois un petit félin qui a opté pour une autre stratégie : la force brute et systématique contre tous les autres chats. Il y a toujours, inscrit dans son génome, le besoin d’un lieu sûr, mais ce besoin n’est réellement ressenti qu’en présence d’animaux nettement plus grands que lui. Pour le reste, on est en présence d’une autre stratégie d’existence ; celle-ci, à l’égard des congénères, est basée sur l’agressivité à outrance : ton refuge est le mien quand je veux.
Deux stratégies bien différentes, donc : soit on investit dans son lieu sûr, soit on investit régulièrement celui des autres. Tant que le chat en question est grand, vigoureux et agressif, une stratégie de prise, par la force, du bien d’autrui, fonctionne autant que celle de défense minimale de son bien, puis de fuite le cas échéant. Mais en cas de maladie, ou de vieillesse, gare… Les autres chats, qui auront dû subir la loi d’airain du grand belliqueux, méchant et fort, le lui feront payer… car les chats ont de la mémoire et la dent longue.
Pour les humains, on peut observer les mêmes types de comportement, définir les mêmes profils psychologiques. Toutefois, l’arbre des convenances sociales cachant la forêt des interactions, on le conçoit moins bien !
***
Le hasard, nécessaire à tout démiurge
août 16th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #87.
Un observateur lucide du monde vivant doit constater que, si celui-ci forme un mécanisme singulièrement complexe, parfois prodigieux, il s’avère, par ailleurs, souvent détraqué, ou étrangement mal adapté.
Aussi, n’en déplaise aux croyants, les merveilles de ce monde ne prouvent en rien l’existence d’une intelligence créatrice. Il y a le reste, qu’il faut aussi mentionner…
De plus, un mécanisme, même extrêmement sophistiqué, peut parfaitement apparaître de façon naturelle au cours du temps, par complexification spontanée du simple. C’est d’ailleurs un processus qui n’a pas plus de raisons de se faire… que de ne pas se faire. Si l’on éprouve le sentiment que ceci, ou cela, devait nécessairement se faire, c’est simplement… parce que l’on se trouve à l’intérieur du mécanisme. C’est un biais de perception.
Quant à tenter, par la pensée et le calcul, par inférences successives, de remonter le passé, pour reconstituer l’histoire de cette complexification, afin d’éventuellement découvrir “ l’acte créateur ”… il y a un moment, au cours de ce processus de reconstruction cognitive, où l’on ne peut rien déterminer de précis, chaque option possible, à chaque bifurcation en arrière du scénario évolutif, se trouvant à peu près aussi vraisemblable que l’option contraire. Ainsi, en l’absence de données paléontologiques suffisantes, l’éventail des possibles va tellement en s’élargissant, à chaque étape d’une reconstitution descendant toujours plus profondément dans les strates des éons du temps, qu’inévitablement on s’enlise, à un certain moment : on n’a plus rien sous la main, et plus rien à voir.
Cela étant, pour en revenir aux cafouillages, innombrables, du monde vivant : n’en déplaise aux athées, ils ne prouvent, en rien, l’inexistence passée, ou présente (“ Dieu est mort ”), d’un créateur, disons intelligent, de ce monde. En effet, tout créateur du monde, vu l’étendue et la durée de son action, ne pourrait qu’avoir bafouillé et cafouillé dans son œuvre… d’autant que la possibilité même de ces ratages s’avère une condition préalable à tout processus de création. Plus fondamentalement, si dieu omnipotent il y eut, et en admettant qu’il fût adroit généralement, il fallut bien qu’il créât le hasard, pour se donner une chance… d’être créatif !
Les cafouillages et le hasard n’excluent donc pas l’existence d’un ou de plusieurs démiurges, quasi omnipotents, à l’origine du temps – pour autant que cette dernière notion ait un sens. Quant à leurs intentions…
***
La mémoire courte et les vastes liens à soi
août 16th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #86.
C’est assez curieux : les gens à la mémoire limitée se plaisent, néanmoins, à imaginer, partout autour d’eux, l’existence de liens dans le monde. Liens à la teneur très vague, certes… mais nombreux et extensifs. Ce monde qu’ils traitent par ailleurs comme le leur – car la plupart des liens s’établissent avec eux-mêmes. Chacun de ces deux processus mentaux est inattendu, en l’espèce, mais c’est leur conjoncture qui donne particulièrement à réfléchir. Il y a là plus qu’une coïncidence psychologique.
Celui qui a bonne mémoire peut, plus naturellement, voir les liens réels entre les choses et les événements, cela tombe sous l’entendement. Mais il se trouve, aussi, avoir une meilleure conscience des innombrables cas où il n’y avait aucun lien à déterminer, seulement des coïncidences et des ressemblances fortuites ou accidentelles… à noter dans un coin de sa mémoire, c’est tout.
Ainsi, avec une mémoire vaste et longue, on conserve à l’esprit non seulement la partie visible ou explicable de l’iceberg-monde, mais aussi sa plus grande partie, celle située sous la surface et celle des événements fortuits.
D’un autre côté, si la mémoire est plus courte – et plus floue – on imagine volontiers des liens, partout… entre toutes les choses et tous les événements. Avec soi-même au centre de cette vaste toile. Plus la mémoire est limitée, plus de tels liens sont imaginés vastes et nombreux. On voit mal les détails de l’iceberg et on n’imagine pas du tout sa partie immergée… néanmoins on se perçoit en interaction avec l’iceberg.
On n’accepte pas que la plupart des choses sont simplement inaccessibles et ne peuvent être appréhendées. On manque de mémoire, par là de perspective, pour réaliser la profondeur du chaos… ne fût-ce que celui qui bée en soi. On ne voit pas, on ne veut pas envisager le désordre et le hasard omniprésents, qui règnent sur le monde… soi-même inclus. D’une fois à l’autre, on oublie tout… et on compense en imaginant – en s’imaginant au monde.
La conception de l’univers est celle d’une trame bien faite… dont on se trouve le centre.
***
Des recommandations avant toute chose
août 15th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #85.
2018.08.10 – Un article grand public annonce des problèmes cardiaques pour ceux qui dorment dix heures ou plus. Évidemment, cela reste flou dans l’énoncé… et on subodore que le journaliste a compris de travers.
Vérification : l’article épidémiologique évoque bien, comme on pouvait s’en douter, une simple corrélation… et aucune relation de cause à effet ne peut être établie dans le cadre de l’étude.
Toutefois, cela n’empêche pas les auteurs, dans leur conclusion, de procéder à des recommandations… en particulier de ne pas dormir plus de huit heures ! Pourtant, on peut soupçonner que les grands dormeurs se protègent, sur le plan cardiaque, par leurs longs sommeils…
Une relation de cause à effet a été inventée – et elle est définie dans le moins vraisemblable des deux sens possibles ! Mais bien dans le sens voulu par l’air du temps.
***
L’espérance qui tue
août 14th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #80.
Années 50 ; au nom d’une doctrine de psychologie à la mode, le comportementalisme ou behaviourisme, on procède sans hésitation à de nouvelles expériences animales cruelles, les anciennes ne suffisant pas. Des pigeons sont dressés à obtenir leur nourriture en tapotant du bout du bec une barre. On supprime la nourriture ; comme prévu, après un moment d’essais stériles, les pigeons cessent de solliciter la barre.
D’autres pigeons ont été conditionnés à un distributeur aléatoire, qui dispense ses grains au petit bonheur la chance. Après un temps, à ceux-là aussi on supprime la nourriture. Ces pigeons-là, toutefois, ne s’arrêteront jamais dans leur démarche devenue inutile. Ils continueront, sans cesse, à taper sur la barre, jusqu’à ce qu’ils s’effondrent, épuisés. Ils mourront d’inanition, ne quittant pas la barre sur laquelle ils auront jeté leurs dernières forces.
Les interprètes superficiels en déduisent quelque chose quant à l’intelligence des pigeons. Alors qu’il s’agit de tout autre chose : la difficulté, pour un organisme conscient, d’imaginer une réalité entièrement stochastique, et plus particulièrement l’extrême de distribution probabiliste le plus déplaisant de celle-ci. Ces malheureux pigeons sont ainsi en bonne compagnie avec les joueurs de loto ou de casino, ou avec ceux qui jouent à la bourse…
Tous, le pigeon, le joueur, le spéculateur, iront répétant, répétant leur démarche, jusqu’à la ruine, jusqu’à leur épuisement… Allant jusqu’à mourir auprès de leur machine dispensatrice, capricieuse et divine, ou dans le temple indifférent à leurs espoirs.
Quand les gains et les pertes ont existé dans le passé, de façon certes très aléatoire, mais suffisante, dans l’ensemble, pour que cela ait valu la peine de persister… on se rappelle qu’il y avait, des fois, où il avait fallu, pendant très longtemps, taper du bec, jusqu’à ce qu’enfin l’on reçoive un grain… Alors, il ne faut pas perdre espoir…
Par ailleurs, dans la situation actuelle de pénurie prolongée, on a peine à réaliser que l’on attend depuis beaucoup plus longtemps que jamais… De toutes façons, même si on le réalise, on se dit que certes… c’est plus long que d’habitude, mais forcément cela reviendra – il faut espérer !
Spes, ultima dea. Espérance, ultime déesse…
Ainsi, la mémoire, lointaine, de quelques grains, reçus au hasard, suffit-elle à assurer qu’un mécanisme de vie courant, fondé sur l’espoir, se transforme en activité de mort programmée.
***
Tous ces êtres…
août 14th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #79.
Tous ces êtres que j’ai pu croiser ou côtoyer, qui avaient besoin d’aide ou de réconfort, combien sont-ils avec qui je n’ai pas su y faire, pour qui je n’ai rien pu faire, ou pour lesquels il n’y avait rien à faire. Tous ces petits êtres… mais aussi d’autres, plus grands… que j’ai aimés ou admirés, et qui sont morts. Tout cela est si irréversible.
Étendu sur le dos, dans un lit d’hôpital, ou assis dans un siège d’avion, je tente de me les repasser en mémoire. Pour certains déjà, il ne me reste qu’un brouillard blanc, où j’entends comme un rappel, que je dois me souvenir, qu’il y avait un être, qu’il y avait un nom… ou que j’avais donné un nom…
Tout s’estompe, alors que je me bats pour leur rester fidèle, à ces feux follets de l’existence. Rien à faire, après que la mort les aura rattrapés, le néant éteindra jusqu’au souvenir qu’ils m’avaient laissé… souvenir que je tente, en vain, de raviver.
***
L’abîme et la fourmi
août 13th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #78.
Temps de méditation. Calmer l’agitation des processus mentaux. Première étape, voir lucidement : quel désordre, quelle pauvreté intellectuelle, sentimentale et existentielle… Ce que l’on perçoit du monde intérieur et extérieur ne représente qu’une petite surface de l’océan, juste le voisinage immédiat.
Comme il s’avère difficile, dans ces conditions, de se représenter mentalement cette immensité. L’ailleurs, le plus loin… on ne peut que l’inférer : la surface des mers doit avoir une apparence, des propriétés à peu près semblables à celle des flots alentour… sans doute. Mais les abîmes de l’océan… la profondeur, peut-être sans limite, des cieux… on les imagine mal.
On croit, du moins, pouvoir comprendre quelque chose au monde environnant proche, aux pulsions et aux pauvres pensées intérieures… et tout ce que l’on voit, ce sont quelques centaines de mètres carrés d’une surface mouvante, elle-même insaisissable. Tout ce que l’on perçoit de soi, si l’on s’avère lucide, c’est la course aveugle et chaotique d’une fourmi, elle-même aux contours un peu vagues, se mouvant péniblement dans un espace inconnu, se cognant ici, se cognant là… avançant vaille que vaille ! Seul l’effort consenti semble réel…
***
Appréciation des risques majeurs et des faibles probabilités – de l’individu à l’espèce
août 12th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #77.
Les êtres humains, pour la plupart, le plus souvent, tendent à n’accorder qu’une attention flottante aux risques à faible probabilité, même lorsque ces derniers sont en rapport potentiel avec des événements dévastateurs.
Ces risque-tout (qui n’ont pas conscience de l’être !) prennent distraitement le volant… alors qu’ils se retrouvent ainsi aux commandes d’un véhicule de mort, ou pire. Ils vivent tranquillement au pied d’un volcan ou sur une faille sismique, au pied d’un barrage ou dans une zone de stockage d’hydrocarbures. Ils ne prennent pas des précautions élémentaires d’hygiène, qui pourtant éloigneraient d’eux la grande faucheuse. Ils laissent des entremetteurs inconnus gérer l’ensemble de leurs actifs financiers, achetant, comme dans un état second, des produits qu’on leur présente benoîtement, ne gardant pas à l’esprit les risques d’effondrement de la valeur vénale… Ils font de leur “ smartphone ” et de leurs objets “ connectés ” des cahiers d’adresse détaillés et des porte-documents fournis, qu’ils laissent en évidence, devant leur porte d’entrée, somme toute…
C’est à l’avenant.
En cela, ils ressemblent à ces antilopes qui broutent tranquillement, le jour, non loin d’une troupe de lions faisant la sieste, au lieu de faire du chemin pour s’en éloigner – que sont donc un peu moins d’herbe et de la fatigue supplémentaire, même sous un soleil cuisant, comparées à la mise à mort, hautement possible, dans quelques heures ? Mais non ; elles restent. Elles auront peur la nuit, très peur, de la même façon que les humains tremblent lors de la secousse sismique, gémissant : “ Mais que suis-je donc venu faire là ? Misère ! J’aurais dû… ”. Trop tard.
Ce comportement imprévoyant s’avère, de la sorte, aussi courant dans le monde animal que dans le monde humain. Dans l’ordre de survie d’une espèce animale, il apparaît ainsi que le produit multiplicatif d’une faible probabilité, fois un résultat nuisible, même à l’extrême, pour un individu, n’a pas assez d’incidence, en termes évolutifs, pour que soit génétiquement programmé, dans l’espèce, un comportement de prise en compte du risque ultime. Car tout cela a peu d’importance dans l’ordre général des choses… En effet, seuls quelques individus, ou de petits groupes, paient le prix fort de l’imprévoyance… de temps en temps. Pour le reste, le troupeau survit et continue son errance. Se reproduisant quand même, entre deux tragédies individuelles. Sous le ciel indifférent.
***
L’étonnante variété des types psychiques félins
août 9th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #70.
Les observateurs attentifs ont constaté que les moutons, si méprisés, présentent une diversité impressionnante de psychismes individuels. Quant aux chiens, mieux étudiés, ils démontrent une variété de types psychiques aussi étendue que chez les humains.
On sait moins observer les chats, plus cryptiques dans leurs expressions et leurs comportements. Néanmoins, si l’on procède correctement à cette observation, il m’apparaît qu’on aboutit à cette intéressante conclusion : la diversité des types psychiques semble plus marquée chez les petits félins que chez les humains ou les chiens !
Je me fonde, entre autres, sur l’observation personnelle, de très près, de neuf petits chats, très différents l’un de l’autre, avec lesquels mon épouse et moi-même avons partagé un temps de notre vie : Aswad, Sacha, Micha, Champi, Lucie, Schahpour, Chatoune, Chamane et Gribouille.
En y réfléchissant bien, on peut concevoir la raison principale de ce phénomène : les félinés, très individualistes, ne subissent pas la pression de conformité sociale, mimétique ou biologique, propre à des animaux aussi grégaires que les grands caninés, ou les simiens, par exemple.
***
Ailleurs n’est pas distrait
août 8th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #66.
Le mot “ distrait ” sert à qualifier celui dont l’esprit vagabonde tellement qu’il n’est pas à ses actes, au point que sa capacité de concentration s’en ressent. Le même mot est utilisé, à mauvais escient, pour qualifier celui dont l’esprit se trouve, très intensément et durablement, consacré à une ligne de pensée… parfois au détriment de ses interactions avec le monde extérieur.
De fait, seul le premier est réellement distrait, son esprit dérivant trop volontiers un peu partout. Le deuxième se trouve plutôt absent… fixé dans un ailleurs précis ; il n’est justement pas distrait par grand-chose, y compris par les aspects concrets de la vie. Enfant, j’étais perplexe que l’on me qualifiât de “ distrait ”. Je ne voyais pas très bien ce que l’on pouvait me reprocher.
Pièges et limitations de la langue… avec tout l’impact que cela peut avoir sur des existences !
***
Conjonctions
août 7th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #65.
Mais-ou-et-donc-or-ni-car. Que-puisque-lorsque-si-comme-quand. Deux listes bienheureuses de mon enfance, petits mots de rien du tout mais si puissamment structurants.
Hélas… Depuis les années 1980, les conjonctions de coordination et de subordination se trouvent de plus en plus traitées, même dans la langue française, comme des variantes syntaxiques de la locution adverbiale “ et puis… ” – locution qui aura, elle-même, perdu toute valeur d’introduction d’une nouvelle raison dans le discours !
Résultat de cette dérive langagière : le contenu sémantique des phrases s’en trouve énormément appauvri, jusqu’à la perte de tout sens réel.
***
Le miracle de la ponctuation
août 6th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #61.
L’usage de la ponctuation a deux conséquences quasi miraculeuses. Pour autant qu’elle soit correctement utilisée, bien entendu, elle assure des phrases aussi peu ambiguës que possible, donc plus rapidement compréhensibles pour le lecteur.
Par ailleurs, grâce au temps de réflexion supplémentaire qu’elle exige de la part de celui qui écrit, elle contribue à diminuer l’émission de textes indigents… et indigestes. En ralentissant ainsi la production d’écrits qui, autrement, seraient trop rapidement produits, la ponctuation contribue à la clarté dans le monde.
À l’instar de la pratique de l’orthographe et d’une syntaxe correcte, ou encore des règles de l’expression poétique, on voit se confirmer, dans ce cas également, que les contraintes de locution renforcent la qualité et l’intelligence de l’expression.
***
Correctement marcher et parler s’avère toujours nécessaire
août 6th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #57.
Ceux qui estiment que les nouvelles technologies ont fait disparaître l’utilité à pratiquer correctement une langue… pensent-ils, également, qu’elles ont rendu caduque la nécessité de savoir correctement marcher ?
***
Une musique pour enfants, une autre pour adultes mûrs
août 5th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #53.
Les Anglais, les Écossais et les Irlandais ont des traditions populaires d’airs entraînants, que l’on peut siffler. Ils s’avèrent ainsi très doués pour les comptines et les historiettes. Des musiques pour enfants, très réussies.
À l’opposé, il y a les airs profonds, tout intérieurs, subtilement travaillés, des traditions andalouse et castillane : de la musique pour adultes mûrs. Pas du tout la tasse de thé des anglo-saxons…
***
Moitié-forte, le currawong courageux
août 4th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #50.
2015.08.25 – Les currawongs sont de très grands oiseaux autralasiens du genre Strepera, qui ne sont pas des corvidés allongés et au long bec, mais des passereaux artamidés aux yeux d’un beau jaune vif ; ils poussent des appels très étranges, à l’origine de leur nom vernaculaire et de leur nom de genre. Ils ont une façon inimitable de se laisser tomber de branche en branche, et de se déplacer au sol sans discrétion aucune, de par leur taille et leur démarche gauche. Ce sont de grands sauvages, à l’intelligence sous-estimée à cause de leur timidité.
Un jour sur le deck de notre maison construite sur pilotis, soit sur la plate-forme de la vérandah, je remisais avant le soir les graines pour oiseaux, celles-ci n’étant pas destinées aux rats, sortant la nuit. Un currawong, de loin, observait, régulièrement, la scène. Pacifique comme tous les siens, il n’avait jamais dérangé les petits oiseaux se nourrissant. L’une de ces graines tombe entre deux lattes. Ni une, ni deux : il s’envole et se précipite droit sous la maison à la recherche de celle-ci. Il n’avait pas eu la possibilité de la voir passer à travers le plancher du deck, car la partie inférieure de la maison était cachée par un treillis de bois. Il avait inféré, avec une sagacité immédiate…
Outre leur intelligence de grands modestes, il convient de signaler que, lorsqu’il le faut, comme la plupart des oiseaux, les currawongs savent se montrer courageux. J’ai vu un couple de parents chasser, avec détermination, un très gros chien qui s’approchait trop près de leur petit. Par ailleurs, ils sont coriaces : j’en ai vu survivre à de longues sécheresses et à des tempêtes terrifiantes.
J’ai aussi eu l’occasion d’assister, pendant des semaines, au combat silencieux de l’un d’eux, contre une paralysie progressive de la moitié droite de son corps. J’étais plein d’admiration de le voir réussir à voler, en un vol bancal, mais vol quand même. Réussissant efficacement à se nourrir par lui-même. Trop farouche pour se laisser approcher, comme tous ses congénères. Ces derniers le laissaient en paix, à la différence de ceux de « Sur-une-patte », la magpie handicapée…
Je l’appelais « Moitié-forte ». Rien qu’à l’ouïe, je pouvais déterminer sa présence, car il avait une façon bien à lui de sautiller dans l’herbe et dans les feuilles au sol. Avec son bec de longueur intermédiaire, je n’arrivais pas à déterminer son sexe.
Un jour, au petit matin, je l’ai retrouvé mort ; pas de blessure sur lui, c’était peut-être la maladie, responsable de sa paralysie, qui l’avait tué. Même tout tordu dans sa dernière convulsion, il restait beau. Si élancé, si élégant dans son éclatant plumage noir et blanc.
Je réalisai alors combien il avait été vital, pour le déraciné que j’ai toujours été, qu’une longue partie de mon existence se fasse au contact étroit de la nature profonde. Ces dix-sept années passées dans le bush australien m’avaient donné une précieuse expérience. J’ai beaucoup appris de la vie, et sur elle, grâce à ce contact.
Maintenant, je tourne la page du grand livre de la vie, littéralement – et je crois avoir suffisamment connu, évolué et mûri pour écrire un peu, en particulier sur les êtres que j’ai eu la chance de pouvoir aimer et admirer.
***
Deux approches différentes de la conscience
août 3rd, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #47.
Les platoniciens, qu’ils soient idéalistes ou spiritualistes, ont une analogie moderne pour résumer le problème de la conscience : la voix émanant d’une radio n’a pas son origine à l’intérieur de celle-ci ; de même, selon eux, l’esprit ou la conscience se manifestant à partir d’un corps humain ont leur origine “ ailleurs ”.
C’est une position qui semble raisonnable, a priori… sauf qu’elle se révèle un oreiller de paresse. Cette origine “ ailleurs ”, qu’ils invoquent ainsi, s’avère un au-delà physiquement inaccessible ; par là, aucun examen des ombres passant sur le mur de la caverne ne présente la moindre utilité, en définitive. Autre corollaire de leur position : on peut, par contre, se fier à certains “ clairvoyants ”, qui se trouvent capables de “ communiquer ” avec l’au-delà et ses esprits. Dans les deux hypothèses, l’intelligence se prouve inutile.
Pour ma part, je préfère l’approche plus matérielle des héritiers spirituels de Démocrite et d’Aristote, qui étudient l’objet radio en le démontant, réfléchissent sur les phénomènes électro-magnétiques, et analysent les sons émis par La Voix du Maître, cherchant à déterminer s’il y a un message… ou, simplement, si l’on peut vraiment donner un sens à tout cela.
On ne trouve pas forcément beaucoup plus de cette façon, mais c’est une question de goût personnel. Qui s’est confirmé avec l’âge, en ce qui me concerne.
***
Comprendre, puis accepter l’ordre des choses
août 2nd, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #44.
Depuis ma petite enfance, il m’a fallu des décennies d’efforts opiniâtres pour comprendre la réalité des choses – une réalité dans laquelle l’organisme qui me constituait avait bien de la peine à trouver ses marques… Je n’ai pas beaucoup aimé ce que j’ai trouvé, que ce soit au-dehors ou au-dedans, ou entre les deux…
Aussi, mon autre effort, tout aussi tenace, a-t-il consisté à accepter, avec équanimité, l’ordre des choses.
***
La chatte qui défendait ses petits
août 2nd, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #43.
Banlieue de Khartoum-Nord, Soudan. Petite enfance, fin des années 60. De ma chambre, j’entends soudain des cris déchirants. Je me précipite sur le balcon. Au loin, sur le vaste terrain vague séparant notre maison du Nil Bleu, je vois un chat aux prises avec trois chiens errants. Je ne comprends pas : pourquoi ne s’enfuit-il pas ? Pourquoi reste-il ainsi adossé à un tronc mort couché, ne quittant pas sa place ? Il donne des grands coups de griffe, à gauche ! à droite ! poussant des cris terrifiants ! mais les trois chiens persistent ! Le chat n’a aucune chance !
Affolé, j’appelle ma nounou de Haute-Égypte : « Yoya ! Yoya ! » Elle arrive en traînant un peu. « Yoya, vite, il faut aller là-bas sauver ce chat ! – Quoi ? Pas question, nous pourrions nous faire mordre, et puis ce n’est pas l’heure de la promenade ! – J’y vais tout seul alors ! – Quoi ?! Tu seras puni par ton père ! – Yoya ! Je t’en prie ! – Bien, bien. »
Quand nous arrivons sur place, les chiens ont disparu. On retrouve le chat, mort dans une dernière position de combat, la bouche grande ouverte, les griffes sorties. À côté, deux chatons massacrés. Au pied du tronc couché, un trou profond à la terre fraîchement retournée. En un éclair, je comprends tout : c’était une mère chatte, dans le terrier elle cachait ses petits. Les chiens les avaient dénichés.
La chatte avait défendu ses petits, jusqu’au bout, dans un combat désespéré.
Je pleure sans dire un mot. La nounou ne veut pas le montrer, mais elle est émue. Nous continuons notre promenade, en silence.
Je n’ai jamais oublié cette chatte. Cette mère héroïque, combattant jusqu’à son dernier souffle. Expirant dans la souffrance et le désespoir, sachant qu’elle n’aura pas sauvé ses petits.
***
La chatte, incomparable éducatrice
août 1st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #41.
La chatte est une incomparable éducatrice de ses chatons. Vigilante, patiente et persistante. Sous leurs regards attentifs de petits félins, elle va gratter lentement le sol ou la litière, encore, encore, puis enterrer encore plus soigneusement ses déjections, le tout posément. Ensuite elle lèche le ventre de chaque chaton, les encourage à persister lorsqu’ils grattent à leur tour, les incite encore lorsqu’ils enterrent, maladroitement, leur petit besoin.
Un peu plus tard, en gestes délibérés et précis, elle grimpe sur la première branche d’un arbre, puis, par des appels calmes mais pressants, encourage ses petits à faire de même. Et ils le font – gauchement mais en s’appliquant, imitant laborieusement les gestes de leur mère, au point de tourner autour de l’arbre exactement dans le même sens qu’elle, et de suivre précisément les mêmes étapes dans l’ascension. La descente se révèle la partie la plus délicate…
Au cours d’un autre exercice ardu, elle apportera une proie morte. Elle les stimulera à mordre dedans, puis elle passera au plus difficile : leur apprendre à en manger. Ils finiront par le faire, comme elle, délibérément, précautionneusement.
***
Une mère prudente, prévoyante, prompte et précise…
août 1st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #40.
Une vieille dame hébergeait une chatte qui avait mis au monde trois chatons qu’elle allaitait dans une petite boîte, au salon. Si on sonnait à la porte, la dame allait ouvrir à des visiteurs venus voir les chatons et les amenait aussitôt dans la pièce en question… mais, entretemps, la mère avait déjà disparu avec ses trois petits !
Sa cachette est toujours restée introuvable – aucun des rejetons ne faisait le moindre bruit. La chatte, prévoyante, avait bien par avance reconnu les lieux ; elle s’était préparée une retraite sûre et avait déterminé le meilleur trajet pour y parvenir. Dans le court laps de temps entre le moment où l’on sonnait à la porte et celui où la dame faisait entrer ses visiteurs au salon, la mère devait procéder à trois transports, un chaton à la fois, de la boîte à sa précieuse cachette.
Jamais la dame ne l’a vue faire ! La chatte procédait à l’évacuation de ses trois petits dans la discrétion la plus totale, avec une rapidité confondante. Elle savait parfaitement ce qu’elle devait faire, savait exactement comment le faire. Précision, promptitude, économie de mouvements.
On notera aussi qu’une mère n’est jamais trop prudente : la chatte ne ramenait ses chatons dans la petite boîte au salon… qu’après s’être assurée qu’on ne l’observait pas.
***
Sur-une-patte, la magpie rejetée
juillet 31st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #39.
2015.08.07, hiver austral – Depuis quelques jours, j’observe une magpie, femelle, jeune apparemment, plutôt maigre, boitillant piteusement, restant figée sur place quand elle me voit, et bizarrement posée sur son ventre, un peu de travers. Petit à petit, à force de rencontres, elle se détend.
Depuis quinze jours, résolument, je vais, je viens, de quatre conteneurs maritimes que je vide systématiquement, à un grand feu brûlant devant. Les conteneurs sont remplis d’articles scientifiques et techniques anciens, empilés sur des bibliothèques métalliques démontables, c’est tout très intéressant et bien trié, mais je dois débarrasser pour le retour en Europe. À Kangaroo Island, je les avais transformés en compactus. Trente-six ans de documentation qui partent au feu. Je ne garde que ce que je compte relire.
La magpie demeure dans le coin, me laissant parfois approcher à moins de deux mètres. Je lui ai installé une petite soucoupe avec de l’eau, elle vient y boire. À cinquante mètres de là, deux malheureux jeunes chiens, attachés à longueur de journée, jappent lamentablement, parfois pendant des heures. Ils sont beaux, des red kelpies, se tenant droits, ils ont des oreilles pointues, ce sont de vrais canidés. Au moins sont-ils à deux, mais quelle jeunesse…
Un matin, la magpie s’introduit d’un coup d’aile décidé dans le conteneur aux portes grandes ouvertes, s’installe à un mètre vingt de moi sur une bibliothèque, et m’observe ainsi pendant un quart d’heure. Je lui parle, je continue de trier, elle me suit de ses yeux rouges, presque brûlants par l’intensité du regard. Je peux l’observer à mon tour plus attentivement : sa patte droite est complètement tordue, inutilisable. Je ne vois pas de fil de pêche dont je devrais éventuellement la libérer, comme je l’avais déjà fait pour deux de ses congénères, rien à faire pour moi de ce côté. Soudain, elle s’en va. J’ai compris.
L’après-midi je reviens avec des croquettes pour chats. Les deux chiens jappent toujours, elle-même repose tranquillement couchée sur le ventre, toujours dans le fossé devant le conteneur. À deux mètres d’elle, je lui lance une croquette, que malgré sa condition d’éclopée elle arrive à saisir du bec dans sa trajectoire ! Elle me regarde : oui, voilà, tu as compris.
Les deux chiens sont soudain silencieux, dressés sur leurs pattes, ils nous regardent attentivement. J’envoie à la magpie cinq croquettes de plus, en visant bien car elle est quand même très handicapée, puis j’arrête afin de lui éviter une indigestion. Les deux chiens observent toujours, très silencieux, leurs belles oreilles dressées, et je les vois penser : là, il se passe quelque chose d’important, soyons bien attentifs…
Je retourne à mon labeur de triage, la magpie s’en va. Les deux chiens resteront silencieux pour le reste de l’après-midi ; ils méditent, leur pauvre jeunesse de prisonniers leur a enfin fourni un sujet digne de leur remarquable intelligence. Quatre individus sensibles et conscients se sont observés, et réfléchissent.
2015.08.09 – « Sur-une-patte » est toujours là. J’appelle ainsi la petite magpie à la patte difforme. Elle me reconnaît de loin, vole vers moi à tire-d’aile. Cette fois, elle se saisit des croquettes d’entre mes doigts, je lui en donne ainsi une dizaine. Le contact est bon, elle aime bien s’installer tout près et me regarder m’activer.
Par contre, je constate avec inquiétude des blessures écarlates sur sa tête, probablement dues aux coups de bec des magpies de son groupe qui l’ont rejetée. Je les vois alentour, l’œil sur nous… et elles ne semblent pas regarder Sur-une-patte avec aménité. Ces passereaux artamidés, très intelligents, qui vivent en groupe serré, sont connus pour leur façon de rejeter, soudainement et impitoyablement, un congénère hors du clan.
2015.08.11 – Depuis le matin, c’est la tempête sur l’île, avec des rafales de pluie. Je suis inquiet pour Sur-une-patte, je ne l’ai pas vue hier… et avec son unique patte, il doit lui être très difficile de s’arc-bouter contre le vent violent. Il est exclu pour elle, dans de telles conditions météorologiques, de sautiller d’un coin à l’autre à la recherche de nourriture, elle se ferait emporter. Elle doit avoir faim en plus de froid. Je pars à sa recherche sous le vent et la pluie.
Je la trouve près de notre propre maison cette fois, je l’ai reconnue de loin à sa démarche particulière ; elle aussi m’a reconnu, car elle s’élève du sol et vole sans hésiter droit sur moi. Cette fois, elle s’installe sur la barrière du jardin. Elle est transie, l’air misérable, ses blessures à la tête sont à vif. Elle se saisit des croquettes que je lui tends, cette fois elle a droit à une douzaine de celles-ci. Je lui parle un peu, elle fait un petit besoin. Tout va bien.
Mais à peine je m’éloigne d’elle, de deux mètres seulement, qu’elle pousse un grand cri ! Woush ! deux autres magpies, venues de nulle part, me frôlent presque et se lancent sur elle ! Elle s’enfuit en zigzaguant, mais par leur chasse habile ses deux adversaires, en parfaite santé eux, s’y prennent avec adresse pour la forcer au sol. Elle se couche sur le dos, poussant de grands cris, et les deux la piquent et la repiquent férocement.
Il m’a fallu quelques secondes pour réaliser la scène ! Je me précipite alors en courant, faisant de grands moulinets des bras, « allez-vous en ! » qu’il leur crie, le bipède lourdaud ! Elles ne s’en vont que lorsque je me trouve à cinq mètres d’elles ! Sur-une-patte profite de la diversion pour s’évanouir dans la canopée touffue d’un eucalyptus mallee.
Bon… Je sens que la survie de la petite handicapée ne sera pas simple… Ses pires adversaires ne seront ni les prédateurs, ni les éléments déchaînés, ni les difficultés inhérentes à sa condition, mais les membres de la communauté qui l’a rejetée.
Il pleut, il vente. Il ne me reste qu’à méditer, devant, au loin, la mer grise et indifférente.
2015.08.12 – Ce matin, la tempête a soufflé encore plus violemment sur l’île. Dans l’après-midi, alors que je me douche, j’entends les cris de détresse typiques d’une magpie recevant une raclée de congénères. Serait-ce Sur-une-patte ? Le temps de me sécher en vitesse, de m’habiller, je sors – mais rien, personne, nulle magpie. Pour moi, c’est comme un grand silence tout autour, malgré les rafales du vent qui continue de souffler rageusement. Sur-une-patte…
2015.08.16 – Cela fait cinq jours que je n’ai plus revu mon amie. Si c’était bien elle que j’avais entendue, il y a quatre jours, elle aurait survécu aux journées de tempête… et peut-être s’est-elle décidée à ne plus sortir des bois, car les membres de son clan, qui l’ont rejetée, sont trop dangereux pour elle. Peut-être… Bonne chance, petite boiteuse, j’espère recroiser ta route. Tu m’as rappelé ce que c’est que de lutter, chaque jour, simplement pour survivre.
Début mai 2016 – Nous quittons définitivement notre grand terrain de Kangaroo Island. Cela fait neuf mois que je n’ai plus revu Sur-une-patte. Mais je ne l’ai pas oubliée. Je lui dédie ce petit journal, rédigé au gré de nos rencontres.
***
Le porteur d’eau et ses petits amis
juillet 30th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #36.
Janvier 2009, été austral.
Suite à une longue sécheresse, l’étang sur notre propriété de Kangaroo Island, quoique profond de plusieurs mètres, s’était retrouvé à sec. Je doublai alors le nombre de récipients emplis d’eau un peu partout autour de la maison, en des endroits où ils seraient à l’ombre pour toute la journée. Afin que les insectes et les petits oiseaux puissent boire sans danger de noyade, je disposai verticalement, dans chaque seau, deux branches lourdes, dont la partie supérieure se retrouvait en appui contre le rebord intérieur, et posai à la surface de l’eau des petits bouts de bois flottant, de tailles diverses : le petit être qui tomberait dans un récipient pourrait agripper un de ces mini radeaux, puis remonter le long d’une de ces branches coupées, jusqu’au rebord du seau. Je disposai par ailleurs trois lourdes pierres autour de chaque récipient, afin qu’ils ne soient pas renversés par de plus grands animaux, maladroits, kangourous, wallabies, possums ou échidnés.
Puis je réfléchis : bien des animaux, nombreux, ne viendraient pas jusqu’ici… leur point d’eau habituel c’était là-bas, à l’étang. J’éprouvais de la peine pour tous les êtres qui ne pourraient plus s’y désaltérer. Voyons… Que faire… Je pourrais déposer, au fond de cet étang à sec, des seaux d’eau, que je remplirais à l’aide du grand réservoir d’eau et de la pompe à incendie que j’avais fixés sur une remorque. Non, cela n’irait pas… Je ne pourrai pas utiliser la pompe pour remplir ces récipients, même son plus faible débit reste puissant et trop d’eau serait ainsi gaspillée alentour ; quant à l’écoulement à partir du petit robinet de vidange, cela prendrait un temps fou pour remplir chaque seau… Par ailleurs, le réservoir était maintenant plein de 800 litres, la remorque s’avérait presqu’indéplaçable sous un tel poids ! Enfin, je l’avais positionnée, près de la maison, exactement là où il fallait pour une lutte contre un incendie, et en ces jours de sécheresse extrême un feu de brousse pouvait nous tomber dessus en quelques minutes… Il était exclu que nous nous retrouvions, pour une heure ou plus, sans cette précaution d’appoint.
Bon… Portant à bout de bras deux seaux d’eau, je fis alors, à pied, le trajet de cent cinquante mètres depuis la maison ; enfin arrivé à l’étang à sec, je les déposai dans la vase, en son fond. Je pris les mêmes dispositions que pour les récipients près de la maison : branches contre la noyade, pierres contre le renversement. Rude tâche, car il faisait chaud.
À mon deuxième trajet, apportant les troisième et quatrième seaux pleins d’eau, je remarquai, déjà, des petits oiseaux perchés sur le rebord des deux premiers récipients. Je déposai ainsi, en tout, huit seaux remplis d’eau, au fond de l’étang à sec. Je m’installai ensuite sur une grande pierre, sous l’ombre d’un eucalyptus géant, pour admirer le ballet des petits êtres de toutes sortes venant se désaltérer. Les petits oiseaux, bien sûr, puis un papillon, une abeille, d’autres insectes… Rapidement, ce fut tout un manège ailé. J’étais heureux.
En fin de journée, je revins avec deux seaux remplis d’eau afin de compléter le niveau de ceux que j’avais installés au fond de l’étang à sec. L’activité de la petite faune auprès de cette oasis artificielle restait importante.
À l’aube du jour suivant, les huit récipients étaient entièrement vides, car les wallabies et les kangourous étaient venus à leur tour, la nuit, et leurs besoins en eau étaient importants. Je pouvais voir leurs empreintes tout autour, dans la vase de l’étang encore un peu humide. Je vis même des traces d’échidné, cela n’avait pas dû être simple pour lui, mais les pierres disposées contre les seaux l’avaient sans doute aidé, il avait pu monter dessus pour accéder à l’eau.
Je repris ma tâche. D’abord rapporter les huit récipients vides à la maison. Au premier voyage effectué avec deux seaux pleins, des oiseaux m’accompagnèrent ; j’étais impressionné, ils avaient vite compris. Tout le long du trajet, j’entendais des petits “ pip ! ”, je discernais des vols rapides, frrout ! Je déposai les deux seaux au fond de l’étang à sec, redisposai six pierres autour d’eux, enfin les branches dedans afin que personne ne se noyât. Puis je repris le chemin de la maison. Je n’avais pas fait quatre mètres que les deux récipients d’eau étaient investis, dans une folle agitation, “ pip ! ”, “ pip ! ”, frrout !
Deuxième trajet, avec les troisième et quatrième seaux remplis d’eau. À peine l’avais-je entrepris, que je me retrouvai environné de papillons blancs ou jaunes, qui voletaient autour de moi. Ils m’accompagnèrent tout le long ! Eux aussi, ils avaient vite compris ! J’étais éberlué, émerveillé. Cette scène est l’un des plus beaux souvenirs inscrits dans ma mémoire.
Je fis encore les troisième et quatrième trajets, jusqu’à ce que huit seaux emplis d’eau se retrouvassent à nouveau au fond de l’étang à sec.
Tout le long, je fredonnais l’air de « Ce petit chemin »[1] :
C’est le rendez-vous
De tous les insectes
Les oiseaux pour nous
Y donnent leurs fêtes !
C’était fatigant, vers la fin le soleil tapait dur déjà, mais j’étais heureux dans mon rôle d’ami à la peine pour les êtres, petits et grands, que je chérissais.
Je persistai ainsi, pendant des semaines, dans ma tâche de porteur d’eau, jusqu’aux premières pluies : des petites flaques d’eau, ici et là, permirent enfin à tous les animaux de se désaltérer.
[1] Chanson de 1933, paroles de Jean Nohain, musique de Mireille.
***
Le macaque bon Samaritain
juillet 30th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #35.
2014.12.21 – En Inde, un macaque a donné, avec persévérance, pendant vingt minutes, des soins de réanimation à l’un de ses congénères, tombé d’un pylône où il s’était électrocuté. Il caresse la victime sans connaissance, la secoue, lui souffle dessus, la mordille, il va jusqu’à la plonger dans l’eau. Ce bain frais réanime enfin l’objet de ses soins.
Lorsque ce dernier reprend ses esprits, le secouriste lui prodigue un dernier petit massage, et puis tranquillement il s’en va…
***
Le chat, incompris et calomnié
juillet 29th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #34.
Au cours de nombreux millénaires d’élevage, peut-être une trentaine de ceux-ci, on a transformé les gènes du psychisme de certains canidés pour en faire des chiens ; des animaux presqu’aussi intelligents que les loups, mais entièrement axés sur l’obéissance à tout ce qui présente forme humaine, et à la satisfaction des moindres caprices de leurs maîtres.
La domestication de certains chats est plus récente, moins d’une dizaine de millénaires. Bien qu’adoucis, en quelque sorte, par leur semi-domestication, ils ont conservé leur quant-à-soi ; sans doute parce que la soumission à l’autorité n’est pas inscrite dans les gènes des petits félidés, à la différence des plus grands canidés, qui s’avèrent des animaux éminemment sociaux.
Le chat, foncièrement indépendant, est farouche, mais également gracieux, au mental comme au physique. Pour comprendre le petit félin, il faut, soi-même, se montrer capable de grand calme, et s’avérer hautement respectueux de la vie, de ses formes… Être en mesure d’apprécier, sous toutes ses facettes, un chef-d’œuvre de l’évolution. Une beauté naturelle, qui se révèle particulièrement sensible et nerveuse, mais à qui l’évolution naturelle, sur des millions d’années, a su enseigner des vertus admirables de maîtrise de soi.
Un animal puissamment sauvage donc, pourtant capable d’offrir le plus charmant des compagnons domestiques. Étonnante combinaison… à la source d’une incompréhension majeure de la part de beaucoup d’humains.
En effet, il apparaît que, de par ses qualités mêmes, le chat soit un des animaux les plus calomniés. J’ai moi-même rencontré un nombre invraisemblable de personnes déclarant, sur un ton sans appel, qu’on ne peut avoir aucun contact valorisant avec un chat… alors que le chien, par contre !… Les chats sont trop individualistes, voyez-vous, et puis… ils sont faux ! Des hypocrites, voilà !
Ce que l’on ne peut comprendre facilement, ou interpréter facilement, s’avérant, par définition, suspect, donc mauvais…
Le grand-père de l’éthologie, Konrad Lorenz [1903-1989], avait fermement réagi contre l’accusation de fausseté, éminemment ridicule, néanmoins souvent portée sur ces animaux : « Je ne vois rien, dans le comportement spécifique des chats, qui offre la moindre prise à cette notion de fausseté. Il y a peu d’animaux sur le visage desquels un observateur averti puisse lire si clairement l’humeur du moment et prévoir quelle conduite – amicale ou hostile – va suivre. » (in So kam der Mensch auf den Hund, 1950 ; tr. fr. 1970 : Tous les chiens, tous les chats).
Pour ma part, des décennies d’interaction avec des chats, de tempéraments très différents les uns des autres, me permettent de corroborer, entièrement, l’appréciation avisée du grand éthologue.
***
Douâ, le génie sur la branche
juillet 28th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #31.
Soudain, un individu à part, sorti d’on ne sait où, se met à pratiquer, tout seul, son génie autodidacte.
Sur la vérandah de notre maison de Kangaroo Island, par un temps idéal, nous lisons avec bonheur, la mer sous les yeux. Tout à coup nous entendons des trilles gracieuses, des sifflements mélodieux, des roucoulements charmants, déclinés sans la moindre hésitation. Étonnés, nous découvrons, perché sur la plus haute branche d’un eucalyptus proche, un magpie mâle, plutôt jeune, encore plus doué pour la musique que ses congénères, tous flûtistes et chanteurs, des grands passereaux artamidés au superbe plumage blanc et noir.
Il resta longtemps à chanter ainsi, pour nul autres auditeurs que moi-même et mon épouse, aucune autre magpie n’étant là pour l’entendre. Par la suite, pendant des mois, nous le retrouvions de temps en temps, toujours dans le même coin. Pour pratiquer ses exercices vocaux, il s’installait à chaque fois sur la même branche haute, nous ne l’avons jamais entendu chanter ailleurs ; et jamais il ne chantait ainsi en présence d’une autre magpie. L’hiver passe, nous ne le revoyons plus. Ô génie solitaire et pudique… Personne ne pourra, ne saura, ne voudra apprendre de toi.
Quelques mois plus tard, il est de retour, le génie musical ! Durant son absence, il a dû observer et écouter attentivement, car voilà-t-il pas que, soudain, j’entends le miaulement bref, discret et cristallin, de Chatoune… mais venant du ciel !
Je suis stupéfait : c’est bien lui ! De retour sur sa branche favorite ! Un petit dialogue s’instaure entre nous ; il a considérablement enrichi son répertoire, non seulement sait-il imiter notre chatte, mais il peut, en plus, jouer les trilles d’un merle, maintenant !
Il s’arrête, je laisse passer un temps bref afin de m’assurer que c’est bien à mon tour, que ce n’est pas une simple pause de sa part… Je me mets alors à siffler et chantonner, quelque chose de concis et de clair mélodiquement. Il écoute attentivement, la tête un peu penchée de côté… puis reprend à sa manière !
Je ressens autant de bonheur que lorsque je jouais, en duo de clarinettes, avec Iovita, mon cher professeur roumain de musique. En hommage à ces deux musiciens sensibles, j’appelle ce magpie doué : Douâ. Deux, en roumain.
***
Le mouvement perpétuel et l’antipathie spontanée
juillet 27th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #29.
Il y a les animaux qui ne se meuvent que si le mouvement leur apporte un avantage clair. Il y a ceux qui bougent tout le temps, au cas où… ils furètent, ici et là. Différence de comportement qui, dans la nature, crée des antipathies spontanées.
La même barrière comportementale sépare les humains en deux catégories distinctes, qui se supportent plutôt mal l’une l’autre.
***
Le film de l’expression
juillet 27th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #28.
L’essentiel de l’expression commence par la posture du corps, se poursuit par l’intonation, enfin se confirme par les premiers mots et leur articulation. Le tout en quelques fractions de secondes.
Ils sont rares, ceux qui s’avèrent capables de percevoir in vivo cet enchaînement. Et ils sont nombreux ceux qui ne perçoivent rien… même au ralenti !
***
La fin des grands totems
juillet 27th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #26.
Depuis la révolution agricole, plus notamment depuis la révolution industrielle, la plupart des sociétés humaines, lorsqu’elles usent d’une comparaison animale pour qualifier quelqu’un, le font d’une façon péjorative.
Il est bien loin le temps des sociétés primitives où l’on se réclamait, avec fierté, d’un animal sauvage et de ses qualités physiques, morales ou cognitives. L’époque du grand totem de la tribu.
***
L’amitié spontanée de certains animaux pour les hommes
juillet 27th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #25.
Konrad Lorenz [1903-1989], grand maître en éthologie, avait intitulé en 1950 un de ses livres : So kam der Mensch auf den Hund (‘ Ainsi vint l’homme au chien ’ – traduction française 1970 : Tous les chiens, tous les chats). Il s’agissait d’une série d’études et de réflexions, émouvantes et très intéressantes, sur la domestication des chiens et des chats. À la fin de son introduction, le sage autrichien faisait signe à ses lecteurs : « À tous ceux qui sont capables d’aimer et de comprendre tous les chiens, tous les chats, ce petit livre est dédié. »
On peut estimer que Lorenz aurait dû titrer son ouvrage : So kam der Hund auf den Mensch. Ce sont des canidés de la préhistoire qui sont venus à l’homme… et pas l’homme à ceux-ci. D’ailleurs, de façon générale, outre des canidés (même le jeune loup isolé !), beaucoup de jeunes animaux sauvages, des équidés, des bovidés (même le bison !), des félidés (même le puma !), s’attachent étrangement à l’homme rencontré dans la nature, et le suivent facilement. Cette forme bipède, inhabituelle, semble exciter leur intérêt autant qu’éveiller leur bienveillance, au détriment de toute prudence.
La domestication de tant d’animaux a ainsi pu se faire à cause d’une inadéquation entre l’instinct de précaution devant l’inconnu, et la curiosité naturelle des jeunes mammifères, cette curiosité s’avérant indispensable à leur développement mental. Homo, bien plus rusé et opportuniste que sage, a su profiter de ce hiatus comportemental, à son avantage. Le plus souvent, hélas, pour le plus grand malheur des animaux domestiqués et celui de leurs futurs rejetons.
***
On n’oublie rien
juillet 26th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #23.
L’acte de création mentale est une parfaite expression de l’asymétrie fondamentale du monde : malgré ses limitations intellectuelles et cognitives, le penseur, ou l’artiste, s’avère quand même bien plus libre dans ce qu’il peut imaginer… que dans ce qu’il peut oublier.
***
Le poème comme épiphanie
juillet 26th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #22.
Soudain, ce qui restait caché se manifeste avec éclat !
Il faut le dire, mais seul le poème s’avère en mesure d’exprimer, un peu, l’indicible, dans sa fulgurance. Le poète écrit alors, mais s’il connaît mal la portée de son œuvre, il connaît sa propre limite. L’écriture d’un poème est une épiphanie d’acceptation – que le monde est étranger à soi, irrémédiablement – et que l’on est ce que l’on est. Une épiphanie dans la beauté rêvée et dans la nostalgie, tout autant rêvée.
***
Langage humain inadapté… à décrire l’évolution naturelle
juillet 25th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #21.
Il convient d’attirer l’attention sur l’inadéquation totale entre le langage humain et les phénomènes évolutifs. Si l’on ne se montre pas extrêmement attentif à cette inadéquation, il s’avère très facile, très naturel… de dire des choses qui n’ont aucune réalité.
L’exemple suivant illustrera le propos. On aime à visualiser sa propre vie comme une succession de décisions… alors que, le plus souvent, cela s’est fait – c’est tout. Aussi la notion de “ décision ” est-elle souvent illusoire, quand il s’agit de la trajectoire de vie d’une personne ; en matière d’évolution naturelle, elle s’avère carrément absurde. Pourtant, nombre de biologistes y succombent, lorsqu’ils présentent “ la Vie sur la Terre ” comme une sorte d’organisme géant, qui aurait comme pris des décisions de “ sélection ”… alors que telle ou telle bifurcation évolutive s’est faite – c’est tout. La sélection naturelle s’avérant un processus passif, aveugle et négatif : ce qui ne peut pas durer… ne dure pas.
Ce qui pourrait durer… durera – peut-être.
Sans doute le langage lui-même, avec l’usage d’un sujet verbal et du mode actif dans la conjugaison, joue-t-il un rôle décisif dans cette méprise généralisée. Le vocabulaire établi n’aidant pas, par ailleurs…
Ainsi, même Darwin [1809-1882], le lent, le prudent, le consciencieux Darwin, s’est-il retrouvé piégé par le langage humain. Il avait bien raison, quand il regrettait, sur le tard de sa vie, d’avoir appelé sa magnifique théorie : “ sélection naturelle ” (“ natural selection ”), plutôt que conservation naturelle (“ natural preservation ”). Dommage, car l’aspect moins personnel et moins actif du mot “ preservation ” aurait effectivement mieux convenu à sa propre description de l’évolution. Et que de phantasmes et de malentendus eussent ainsi été évités, de la part de ceux qui le lisaient mal, malgré toutes ses précautions d’écriture !
***
Reconnaître une rose
juillet 23rd, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #17.
“ Je sais ce qu’est une rose ! – Ah oui ? La décrirais-tu ? – Eh bien, cela fait de jolies fleurs, ça sent bon et ça a des épines. – Mais des centaines de plantes correspondent à cette description… ”
L’interlocuteur, qui n’est pas botaniste, même un tout petit peu, s’avère incapable d’en dire plus sur le sujet, car il ne possède pas les catégories mentales ad hoc. Cela étant, on lui présenterait une autre plante, correspondant à sa description imprécise, il pourrait affirmer, sans commettre d’erreur : “ Ah, mais ça ce n’est pas une rose ! ” Il ne connaît pas, néanmoins il sait reconnaître.
Sur le plan cognitif, on voit bien que l’on est en présence de deux processus mentaux distincts. Il est toutefois rare que l’on réalise concrètement cette différence, et l’on croit volontiers que connaître, c’est être capable de mettre un nom sur quelque chose. En réalité, cela n’est pas vraiment connaître, mais reconnaître, une première étape indispensable dans la connaissance. Curieux, tout de même… car reconnaître, cela devrait signifier : re-connaître.
Encore une situation où le langage trompe allègrement, car enfin, en toute logique, connaissance devrait précéder re-connaissance, et cette dernière ne devrait pas être inférieure en contenu explicite à la première ! Comme quoi les mécanismes cognitifs se déroulent inconsciemment pour l’essentiel. De ce fait, si l’on s’avère peu conscient… de ces mécanismes inconscients… on se prend volontiers, à l’instar de M. Jourdain, pour plus savant que l’on ne l’est.
***
Système vivant n’est pas machine
juillet 21st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #11.
Descartes [1596-1650] était fier d’avoir imaginé l’animal comme une machine ; l’homme, toutefois, subsistant, dans son esprit de philosophe idéalisant des catégories néo-platoniciennes, comme une âme incorporée [1].
L’auteur était intelligent et rédigeait bien, mais ne connaissait ni les âmes, ni les machines, ni les animaux… Nonobstant, son analogie satisfit pleinement les chrétiens en mal de renouvellement doctrinal, ainsi que les vivisecteurs de tous genres qui s’empressèrent de saisir un blanc-seing leur permettant de pratiquer… l’âme tranquille.
Quelques siècles plus tard, ils demeurent nombreux, ceux qui pensent : “ Moi, j’ai une âme ”… pour ensuite traiter les animaux comme des machines. Sauf, peut-être, leur favori (le “ pet animal ” des anglo-saxons), qui, lui, est différent…
L’attachement mental à la notion d’âme répond à des besoins psychiques très primitifs. À première vue, l’analogie cartésienne, entre machine et être vivant, peut sembler plus raisonnable, par sa formulation d’allure plus moderne. Pourtant, il devrait sauter à l’œil, même du plus myope, que c’est encore un non-sens.
Un organe, un organisme, doivent fonctionner, activement, une bonne moitié de leur temps, rien que pour conserver leur intégrité et rester opérationnels. Ce faisant, ils ne s’usent pas, au contraire ils se maintiennent, voire se développent. Le cœur doit travailler sans cesse… pour ne pas se scléroser à ne rien faire ! Tandis qu’une machine, si l’on procède de même avec elle, on ne fait que l’user : certes, elle doit être utilisée un peu, régulièrement, afin de la faire mieux durer, mais, généralement, pas plus de la moitié du temps !
Cette simple observation de bon sens s’avère profonde, car elle permet de pressentir une des différences fondamentales entre une machine et un système vivant : outre sa plasticité structurelle, absente de la machine, une caractéristique essentielle du second est qu’il se nourrit en métabolisant, ce qui lui permet de générer l’énergie biochimique nécessaire à son fonctionnement, mais aussi de renouveler, sans cesse, les molécules de ses cellules biologiques. Ce n’est pas le cas de la machine : l’essence ou l’électricité qu’on lui fournit ne sont que des sources d’énergie, elles ne se trouvent pas intégrées dans sa matière même.
[1] Cf. « Dérive antipodale des mots : cartésien », texte no 111 de Pensées pour une saison – Printemps.
***
Où commence la vie, exactement ?…
juillet 20th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #10.
Lorsqu’on étudie de près les manifestations de la vie, de très près, en ayant recours à la solide méthode réductionniste, consistant à étudier le tout par ses parties, il est un moment de l’investigation où l’objet vivant paraît un ensemble d’objets inanimés – et on ne peut définir avec précision où et quand cette transition a eu lieu… La vie semble s’en être écoulée, comme une eau que l’on aurait vainement tenté de retenir entre ses doigts, dans le noir.
De fait, il est judicieux de savoir jusqu’à quel niveau on peut pratiquer un réductionnisme de bon aloi. Car il y a différents niveaux d’organisation et de complexité du réel, et pour chacun il faut utiliser des outils matériels et intellectuels adaptés. Il est vain de démonter entièrement une montre pour comprendre son fonctionnement si l’on n’a pas la moindre notion de mécanique. Il est vain (et obscène) de disséquer un animal si l’on n’a pas la moindre notion d’anatomie, de physiologie, de biochimie, voire d’écologie.
Ainsi, même de bonnes connaissances, si elles se trouvent limitées à la physique-chimie, ne permettront pas de retirer la moindre information valable de cette dissection. Car un système vivant s’avère bien plus qu’une agrégation d’atomes ou de molécules, aussi complexe et organisée soit-elle, et aussi sophistiqué que soit le modèle descriptif. Une biologie sans biochimie est largement illusoire, mais la biologie n’est pas que de la biochimie… car il y a dans la vie une particularité irréductible à la chimie.
***
La démarche réductionniste et ses différents seuils
juillet 20th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #09.
La démarche réductionniste, consistant à étudier le tout par ses parties et les liens entre celles-ci, offre une garantie de rigueur intellectuelle et se révèle une approche efficace de la réalité. Mais il ne faut pas perdre de vue que la reductio ad absurdum – la réduction à l’absurde – guette l’imprudent se laissant glisser sur la pente de la reductio ad infinitum – la réduction à l’infini…
Il y a plusieurs niveaux de réalité, correspondant à différents plans d’organisation et de complexité. On ne peut appliquer la démarche réductionniste en-deçà d’un certain seuil, défini par l’approche matérielle et l’outil intellectuel que l’on utilise.
Ainsi, il y a un seuil subparticulaire où règne la mécanique quantique. Un seuil atomique, celui de la physique nucléaire. Un seuil moléculaire, celui de la chimie. Un seuil macro-moléculaire, celui de la biochimie entre autres. Un seuil cellulaire, celui de la biologie cellulaire. Un seuil pluri-cellulaire. Un autre lié à l’espèce vivante. Un seuil écologique. Des seuils divers d’intelligence et de conscience. Un seuil planétaire. Un seuil stellaire. Un seuil galactique. Et même, un seuil cosmique.
À chaque changement de seuil, un saut qualitatif s’opère, le tout n’est plus entièrement discernable par ses éléments constitutifs. Ainsi, on ne peut aborder la biologie cellulaire sans biochimie, mais on ne peut l’appréhender entièrement en se cantonnant à cette dernière. La réalité des choses s’exprime en des dimensions très différentes, et il convient de se souvenir que, souvent, le tout s’avère plus que la somme des parties.
***
La fourmi qui devint deux
juillet 18th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #02.
Depuis un long moment (que je ne peux déterminer plus précisément, ne portant pas de montre), j’observe une petite fourmi transportant, à bout de bras, une graine trois fois plus grosse qu’elle. Chaque caillou s’avère une colline à franchir, chaque brin d’herbe couché un arbre tombé, à surmonter. Vainquant toutefois obstacle sur obstacle, avec une détermination farouche, elle avance avec son trésor, porté haut de ses deux pattes avant. Cela zigzague beaucoup mais, en gros, elle a bien parcouru de la sorte quatre bons mètres mesurés en ligne droite !
Puis d’un coup elle pose son fardeau, elle commence plutôt à tirer, à pousser. Elle fatigue… De cette manière, c’est beaucoup plus difficile pour elle… la moindre feuille mouillée s’avère un terrain pénible, sa ligne de parcours se fait de plus en plus chaotique. Soudain, elle laisse tomber et s’en va ! Droit devant elle.
Je me sens bien là où je suis, assis sur ma pierre… Je reste ainsi, à méditer sur cet admirable effort. Tant de peine… tout cela en vain.
Après un bon moment passé ainsi, agréablement, mon œil perçoit une scène… qui me foudroie sur place. Venant de la direction qu’avait prise la fourmi ayant dû renoncer, je vois arriver deux fourmis, ne semblant nullement hésiter sur leur piste. Elles parviennent à la grosse graine, et hop ! elles remettent ça, à deux. Je les vois repartir ainsi, vers la direction initiale, poursuivant sans relâche leur tâche, poussant, tirant. De cette façon, elles transportent sur quelques mètres de plus leur précieux butin, puis leur chemin les fait passer sous de grands épineux, et je dois renoncer à les suivre plus avant.
Deux fourmis… Et si l’une des deux était celle qui avait semblé renoncer, pour, en fait, aller chercher une collègue ?
Émerveillé par cette perspective, je reprends ainsi le fil de ma méditation… et soudain je réalise : quand la fourmi avait abandonné sa besogne démesurée, n’avais-je pas été pris d’un hochement de tête malheureux – n’avais-je pas pensé : courageuse et travailleuse, mais bien peu raisonnable, en définitive, la petite bête… Elle s’était astreinte à une tâche impossible. Comme souvent moi-même, quoi.
J’aurais pu continuer sur cette première pensée, grave mais quelque peu triviale. Par hasard toutefois (aussi par sentiment de bien-être, sous le petit soleil agréable !), j’étais resté assez longuement sur place… alors que rien ne se passait, apparemment. Et là, par chance, j’avais eu l’occasion de voir plus loin, plus profond, par delà les limites usuelles de mon propre temps et de mon propre espace. Et celles de mon espèce.
En tant qu’observateur de hasard, je m’interroge. Combien de fois des animaux, en tant qu’individus, voire des humains appartenant à des sociétés primitives, n’ont-ils pas été ainsi sous-estimés, à cause d’un décalage entre leur temps d’accomplissement d’une besogne, et celui imparti à l’observation qu’on en menait ? Pourtant, si l’observateur ne gère pas son propre espace-temps à l’instar de celui des êtres qui s’activent sous son regard, comment pourrait-il saisir, pleinement, le déroulement d’une action de ces individus ou de ces organismes ?
Je frémis : qu’en est-il des plantes et des champignons ? Comment notre aptitude normale d’attention et d’appréciation des choses pourrait-elle permettre de percevoir, de concevoir les capacités de réalisation de leurs organismes individuels ? De leurs processus actifs dans le long terme… Sous mes pieds, le mycélium d’un agaromycète Armillaria luteobubalina, âgé de plusieurs siècles, s’étend sur des kilomètres carrés…
***