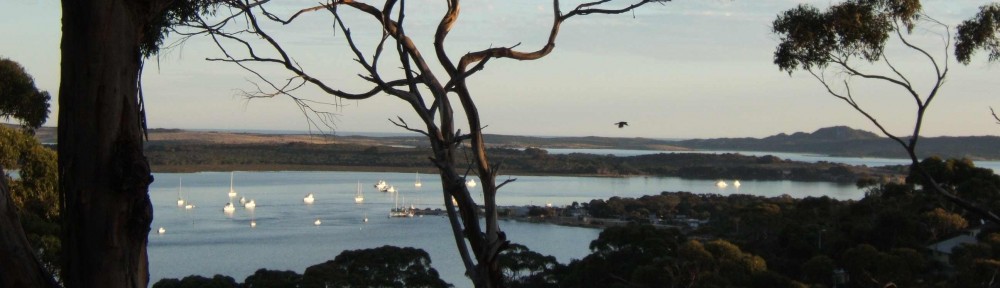Category Archives: être et ontologie
Le mouvement perpétuel et l’antipathie spontanée
juillet 27th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #29.
Il y a les animaux qui ne se meuvent que si le mouvement leur apporte un avantage clair. Il y a ceux qui bougent tout le temps, au cas où… ils furètent, ici et là. Différence de comportement qui, dans la nature, crée des antipathies spontanées.
La même barrière comportementale sépare les humains en deux catégories distinctes, qui se supportent plutôt mal l’une l’autre.
***
La fin des grands totems
juillet 27th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #26.
Depuis la révolution agricole, plus notamment depuis la révolution industrielle, la plupart des sociétés humaines, lorsqu’elles usent d’une comparaison animale pour qualifier quelqu’un, le font d’une façon péjorative.
Il est bien loin le temps des sociétés primitives où l’on se réclamait, avec fierté, d’un animal sauvage et de ses qualités physiques, morales ou cognitives. L’époque du grand totem de la tribu.
***
On n’oublie rien
juillet 26th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #23.
L’acte de création mentale est une parfaite expression de l’asymétrie fondamentale du monde : malgré ses limitations intellectuelles et cognitives, le penseur, ou l’artiste, s’avère quand même bien plus libre dans ce qu’il peut imaginer… que dans ce qu’il peut oublier.
***
Le poème comme épiphanie
juillet 26th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #22.
Soudain, ce qui restait caché se manifeste avec éclat !
Il faut le dire, mais seul le poème s’avère en mesure d’exprimer, un peu, l’indicible, dans sa fulgurance. Le poète écrit alors, mais s’il connaît mal la portée de son œuvre, il connaît sa propre limite. L’écriture d’un poème est une épiphanie d’acceptation – que le monde est étranger à soi, irrémédiablement – et que l’on est ce que l’on est. Une épiphanie dans la beauté rêvée et dans la nostalgie, tout autant rêvée.
***
Ailes et plumes des origines
juillet 25th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #20.
La vie et l’évolution de ses formes constitue une des disciplines d’étude parmi les plus étonnantes. Son objet d’investigation se montre souvent déroutant.
Pour comprendre la vie et toutes ses formes anciennes révélées par la paléontologie, on doit imaginer qu’un organe peut avoir eu une fonction différente par le passé. Il faut ensuite concevoir mentalement, mais d’une façon très concrète, les mécanismes d’ontologie évolutive (on nomme ontologie la partie de la philosophie traitant de l’être, en grec ôn, ontos) : qu’était-ce exactement que ceci, quel pouvait être son lien avec cela, comment la transition s’est-elle faite, exactement…
Ce faisant, on doit conserver à l’esprit la prévalence d’un processus biologique fondamental : dans la nature, un tissu, un organe, un caractère quelconque, qui se sont avérés utiles à une certaine fonction, souvent se retrouvent, progressivement, utilisés, en plus, à une deuxième fonction, annexe d’abord, puis principale, voire exclusive. Dans ce cas, les mécanismes évolutifs modifient, éventuellement, l’organe ou les tissus sous-jacents, par bricolages successifs [1]… les essais ratés ne faisant pas long sous le feu de la sélection naturelle. L’organe crée la fonction, mais la fonction crée l’organe, aussi – c’est un mécanisme rétroactif.
S’il ne reste plus beaucoup de traces ou de reliquats de la fonction primitive, on conçoit qu’il se crée un mystère, au bout du compte… On peut avoir l’impression que des capacités toutes formées sont apparues d’un coup – ce qui, généralement, est loin d’être le cas…
Ainsi, pour un insecte, ses ailes, initialement, lui permettaient (et lui permettent toujours) de trotter sur l’eau, grâce à leur portance. Ensuite seulement lui ont-elles permis de voler, par surcroît.
Quant aux plumes des oiseaux, dans leur aspect présent, elles ne sont pas apparues soudain, ex nihilo : avant de faciliter le vol, elles étaient beaucoup plus simples et contribuaient, d’abord, à conserver la chaleur du corps. Elles étaient duvet, plutôt que plumes proprement dites. Par ailleurs, elles permettaient d’améliorer, esthétiquement, la parade nuptiale, ou pouvaient être gonflées afin de paraître plus gros au regard d’un concurrent, ou d’un ennemi. Plus tard, des pattes avant emplumées se sont avérées pratiques pour chasser des papillons, comme au filet… mais également, suite à une chute intempestive, pour planer sans dégâts jusqu’au sol.
On le comprend, les plumes adaptées au vol actif, dont les fantastiques rémiges (les plus grandes plumes des ailes), ne se sont développées que tardivement dans l’évolution des oiseaux. Pour tout ce processus, inscrit dans la très longue durée, il faut avoir à l’esprit plus d’un million… de siècles.
[1] Cf. infra le texte no 95, « Systèmes nerveux dans un organisme, développements parallèles ». Cf. aussi « Le réveil de formes trop anciennes » ainsi que « Le bonheur et la sérénité, ou bien l’excitation et le plaisir ? », textes nos 104 et 105 de Pensées pour une saison – Printemps.
***
Reconnaître une rose
juillet 23rd, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #17.
“ Je sais ce qu’est une rose ! – Ah oui ? La décrirais-tu ? – Eh bien, cela fait de jolies fleurs, ça sent bon et ça a des épines. – Mais des centaines de plantes correspondent à cette description… ”
L’interlocuteur, qui n’est pas botaniste, même un tout petit peu, s’avère incapable d’en dire plus sur le sujet, car il ne possède pas les catégories mentales ad hoc. Cela étant, on lui présenterait une autre plante, correspondant à sa description imprécise, il pourrait affirmer, sans commettre d’erreur : “ Ah, mais ça ce n’est pas une rose ! ” Il ne connaît pas, néanmoins il sait reconnaître.
Sur le plan cognitif, on voit bien que l’on est en présence de deux processus mentaux distincts. Il est toutefois rare que l’on réalise concrètement cette différence, et l’on croit volontiers que connaître, c’est être capable de mettre un nom sur quelque chose. En réalité, cela n’est pas vraiment connaître, mais reconnaître, une première étape indispensable dans la connaissance. Curieux, tout de même… car reconnaître, cela devrait signifier : re-connaître.
Encore une situation où le langage trompe allègrement, car enfin, en toute logique, connaissance devrait précéder re-connaissance, et cette dernière ne devrait pas être inférieure en contenu explicite à la première ! Comme quoi les mécanismes cognitifs se déroulent inconsciemment pour l’essentiel. De ce fait, si l’on s’avère peu conscient… de ces mécanismes inconscients… on se prend volontiers, à l’instar de M. Jourdain, pour plus savant que l’on ne l’est.
***
Comprendre une araignée
juillet 22nd, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #16.
Dans un coin, une toile d’araignée. Je suis en train de nettoyer, donc je la détruis. Le lendemain, nouvelle toile tout aussi belle et accomplie, destruction tout aussi complète de ma part. Surlendemain, itou… Au quatrième jour, je m’arrête et je réfléchis : après tout, ce petit être ne me veut aucun mal. Moi, par contre, je lui inflige épreuve sur épreuve.
Or, elle ne fait qu’accomplir la tâche qu’elle sait faire le mieux, qu’elle doit accomplir. Elle le fait avec un courage humble et une obstination du travail bien fait qui forcent l’admiration. Elle s’épuise, je finirai par gagner, mais où sera ma victoire ?
Je réfléchis, je médite, je décide : je ne détruirai plus son ouvrage, je ne serai plus son ennemi aveugle.
***
La grande clairière dans la forêt
juillet 21st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #14.
Les plus beaux moments dans la vie d’un chercheur, voyageur tenace jamais au repos, sont ceux-là où une large zone de dégagement et une belle perspective s’offrent enfin à lui, alors qu’il errait peu avant dans les éboulis tristes et sans vie de vallées rocheuses, ou dans la végétation touffue et oppressante de forêts sombres et denses.
À moins que l’on ne s’avère un illuminé, par avance certain de son idée et de son fait, une première phase d’approche se déroule toujours dans la plus grande confusion. Troncs, lianes et feuillages bouchent la vue de partout. Mais on travaille, on apprend à bien manier ses outils, on s’oriente, on défriche son chemin, on avance… et soudain une grande clairière se dévoile ! Exaltation ! Voilà, grâce à tous ces efforts, le centre du monde a été découvert, l’univers est enfin compris !
La plupart s’arrêtent à ce stade, car il s’avère fort agréable et bien sécurisant. Une toute petite minorité de courageux décide d’approfondir… ils s’enfoncent à nouveau dans la forêt. Et alors… une deuxième clairière. Encore une… Encore une ! Il n’y a pas de centre du monde…
Toute exploration, toute enquête s’avère ainsi fatale aux certitudes. D’une façon générale, ceux qui savent, qui savent vraiment… sont ceux-là qui sont arrivés au stade où l’on réalise ne discerner qu’une petite partie de la réalité. Que l’inconnu reste beaucoup plus vaste que tout ce que l’on a pu apprendre jusqu’ici. Et même, beaucoup plus vaste que tout ce que l’on peut encore imaginer…
***
En recherche
juillet 21st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #13.
Toute ma vie j’ai été en recherche… et je le suis encore. Pas à la recherche de quelque chose, car je n’ai jamais rien eu de très précis à l’esprit, mais bien en recherche. Petit animal calme, mais curieux, toujours en investigation.
J’ai trouvé une foule de choses jolies, intéressantes, aimables, mais en beaucoup plus grand nombre d’autres qui étaient laides, menteuses, malsaines. C’est peut-être cela qu’il y avait à trouver, en définitive : la réalité navrante de ce rapport déséquilibré.
***
Système vivant n’est pas machine
juillet 21st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #11.
Descartes [1596-1650] était fier d’avoir imaginé l’animal comme une machine ; l’homme, toutefois, subsistant, dans son esprit de philosophe idéalisant des catégories néo-platoniciennes, comme une âme incorporée [1].
L’auteur était intelligent et rédigeait bien, mais ne connaissait ni les âmes, ni les machines, ni les animaux… Nonobstant, son analogie satisfit pleinement les chrétiens en mal de renouvellement doctrinal, ainsi que les vivisecteurs de tous genres qui s’empressèrent de saisir un blanc-seing leur permettant de pratiquer… l’âme tranquille.
Quelques siècles plus tard, ils demeurent nombreux, ceux qui pensent : “ Moi, j’ai une âme ”… pour ensuite traiter les animaux comme des machines. Sauf, peut-être, leur favori (le “ pet animal ” des anglo-saxons), qui, lui, est différent…
L’attachement mental à la notion d’âme répond à des besoins psychiques très primitifs. À première vue, l’analogie cartésienne, entre machine et être vivant, peut sembler plus raisonnable, par sa formulation d’allure plus moderne. Pourtant, il devrait sauter à l’œil, même du plus myope, que c’est encore un non-sens.
Un organe, un organisme, doivent fonctionner, activement, une bonne moitié de leur temps, rien que pour conserver leur intégrité et rester opérationnels. Ce faisant, ils ne s’usent pas, au contraire ils se maintiennent, voire se développent. Le cœur doit travailler sans cesse… pour ne pas se scléroser à ne rien faire ! Tandis qu’une machine, si l’on procède de même avec elle, on ne fait que l’user : certes, elle doit être utilisée un peu, régulièrement, afin de la faire mieux durer, mais, généralement, pas plus de la moitié du temps !
Cette simple observation de bon sens s’avère profonde, car elle permet de pressentir une des différences fondamentales entre une machine et un système vivant : outre sa plasticité structurelle, absente de la machine, une caractéristique essentielle du second est qu’il se nourrit en métabolisant, ce qui lui permet de générer l’énergie biochimique nécessaire à son fonctionnement, mais aussi de renouveler, sans cesse, les molécules de ses cellules biologiques. Ce n’est pas le cas de la machine : l’essence ou l’électricité qu’on lui fournit ne sont que des sources d’énergie, elles ne se trouvent pas intégrées dans sa matière même.
[1] Cf. « Dérive antipodale des mots : cartésien », texte no 111 de Pensées pour une saison – Printemps.
***
Où commence la vie, exactement ?…
juillet 20th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #10.
Lorsqu’on étudie de près les manifestations de la vie, de très près, en ayant recours à la solide méthode réductionniste, consistant à étudier le tout par ses parties, il est un moment de l’investigation où l’objet vivant paraît un ensemble d’objets inanimés – et on ne peut définir avec précision où et quand cette transition a eu lieu… La vie semble s’en être écoulée, comme une eau que l’on aurait vainement tenté de retenir entre ses doigts, dans le noir.
De fait, il est judicieux de savoir jusqu’à quel niveau on peut pratiquer un réductionnisme de bon aloi. Car il y a différents niveaux d’organisation et de complexité du réel, et pour chacun il faut utiliser des outils matériels et intellectuels adaptés. Il est vain de démonter entièrement une montre pour comprendre son fonctionnement si l’on n’a pas la moindre notion de mécanique. Il est vain (et obscène) de disséquer un animal si l’on n’a pas la moindre notion d’anatomie, de physiologie, de biochimie, voire d’écologie.
Ainsi, même de bonnes connaissances, si elles se trouvent limitées à la physique-chimie, ne permettront pas de retirer la moindre information valable de cette dissection. Car un système vivant s’avère bien plus qu’une agrégation d’atomes ou de molécules, aussi complexe et organisée soit-elle, et aussi sophistiqué que soit le modèle descriptif. Une biologie sans biochimie est largement illusoire, mais la biologie n’est pas que de la biochimie… car il y a dans la vie une particularité irréductible à la chimie.
***
La démarche réductionniste et ses différents seuils
juillet 20th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #09.
La démarche réductionniste, consistant à étudier le tout par ses parties et les liens entre celles-ci, offre une garantie de rigueur intellectuelle et se révèle une approche efficace de la réalité. Mais il ne faut pas perdre de vue que la reductio ad absurdum – la réduction à l’absurde – guette l’imprudent se laissant glisser sur la pente de la reductio ad infinitum – la réduction à l’infini…
Il y a plusieurs niveaux de réalité, correspondant à différents plans d’organisation et de complexité. On ne peut appliquer la démarche réductionniste en-deçà d’un certain seuil, défini par l’approche matérielle et l’outil intellectuel que l’on utilise.
Ainsi, il y a un seuil subparticulaire où règne la mécanique quantique. Un seuil atomique, celui de la physique nucléaire. Un seuil moléculaire, celui de la chimie. Un seuil macro-moléculaire, celui de la biochimie entre autres. Un seuil cellulaire, celui de la biologie cellulaire. Un seuil pluri-cellulaire. Un autre lié à l’espèce vivante. Un seuil écologique. Des seuils divers d’intelligence et de conscience. Un seuil planétaire. Un seuil stellaire. Un seuil galactique. Et même, un seuil cosmique.
À chaque changement de seuil, un saut qualitatif s’opère, le tout n’est plus entièrement discernable par ses éléments constitutifs. Ainsi, on ne peut aborder la biologie cellulaire sans biochimie, mais on ne peut l’appréhender entièrement en se cantonnant à cette dernière. La réalité des choses s’exprime en des dimensions très différentes, et il convient de se souvenir que, souvent, le tout s’avère plus que la somme des parties.
***
De la langue française
juillet 17th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #01.
Je laisse souvent mon esprit vagabonder… Je l’arrête parfois et lui demande : « D’où viens-tu? »
Il me répond, invariablement : « De la langue française. Elle m’a conçu, et nourri. »
***